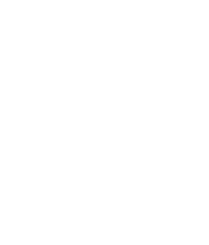À son avènement, l’automobile apportait une solution à un problème sanitaire et environnemental d’importance comparable à celui qu’elle cause aujourd’hui.
Certaines grandes villes, et au premier chef Paris, ont décidé de réduire autant que possible l’utilisation de la voiture dans leurs centres : piétonnisation, transport public, vélos en location, covoiturage, procès-verbaux… tous les outils de la décision politique – allant de l’incitation à la punition – sont bons pour réduire l’utilisation de ce qui est considéré comme une peste pour l’environnement.
Avec près de 100 millions de pièces neuves produites par an et des milliards de tonnes de dioxyde de carbone émises, il faut reconnaître que la voiture, en l’état actuel de la technologie, n’incarne pas au mieux la volonté partagée d’utiliser raisonnablement nos ressources et de réduire notre impact sur l’environnement. Ce moyen de transport représente plus facilement le phénomène d’individualisation de la vie sociale au XXe siècle et le sentiment de liberté qui l’a accompagné, la conquête du territoire, les congés payés… mais pas vraiment une avancée écologique.
Pourtant, il fut un temps où l’automobile a constitué une solution vertueuse à un péril qui pesait sur le destin de l’humanité. Ce péril était tel qu’en 1898 on réunit à New York une conférence internationale pour trouver des solutions au problème. Celle-ci devait durer dix jours, mais, « impuissante face à la crise, la conférence déclara ses travaux infructueux et se sépara au bout de trois jours », précisait en 2007 l’urbaniste américain Eric Morris.
Quel était donc ce terrible péril ? Tout simplement le cheval, dont on dit parfois qu’il est le meilleur ami de l’homme. Pourtant, quoi de plus naturel que le cheval ? Lorsqu’on imagine un décor bucolique et écologiquement vertueux, un cavalier passant dans une prairie sauvage ne fait pas ombre au tableau. En réalité, comme souvent, tout est question de mesure.
Avant l’apparition de la voiture, le cheval était le principal moyen de transport dans les sociétés industrialisées. À New York, par exemple, pas moins de 200 000 chevaux servaient aux livraisons, à la décharge des navires, aux transports des troupes ou des pompiers… Entre 1870 et 1900, le nombre d’attelages a progressé de 328 % dans les grandes villes américaines !
Entre 1870 et 1900, le nombre d’attelages a progressé de 328 % dans les grandes villes américaines
Tout cela occasionnait des problèmes que l’on a du mal à imaginer aujourd’hui. Notamment des embouteillages monstres, au regard desquels les pénibles moments passés coincés dans nos voitures ne sont pas grand-chose. Des accidents mortels survenaient aussi. À l’époque, un New-Yorkais avait deux fois plus de chances de mourir d’un accident de cheval qu’il n’en a aujourd’hui à cause de la voiture.
Mais la pire calamité accompagnant l’essor du cheval comme moyen de transport était le crottin produit. À l’époque, on ne se préoccupait guère du réchauffement climatique, mais le méthane émis par ces déjections était un terrible gaz à effet de serre, comme l’ont souligné en 2009 l’économiste Steven Levitt et le journaliste Stephen Dubner. Un cheval produit en moyenne 11 kilos de crottin par jour, ce qui, multiplié par le nombre d’animaux, constituait des volumes tels qu’il fallait parfois le stocker sur des hauteurs de 20 mètres. Les vieilles maisons new-yorkaises ont des perrons surélevés non parce que c’était la mode, mais bel et bien pour éviter à leurs habitants d’être confrontés aux murs d’excréments équestres.
Si l’on ajoute à cela l’odeur, les mouches, les rats et les maladies qui les accompagnent, on comprend aisément le désastre sanitaire et écologique dû aux chevaux au début du XXe siècle. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, o tempora o mores, l’apparition de la voiture a donc constitué une avancée environnementale.
Gérald Bronner
Gérald Bronner est professeur de sociologie à l’Université Paris-Diderot. Il est l’auteur de la rubrique Cabinet de curiosités sociologiques dans Pour la Science.